Ways of Publishing #2 / samedi 5 juin 2021
Ways of Publishing #2
Samedi 5 juin, 14h-20h
14h-18h. Workshop ouvert aux étudiant·e·s avec Agathe Boulanger, Signe Frederiksen et Jules Lagrange, auteur·rices de Ce que Laurence Rassel nous fait faire, Paraguay (2020)
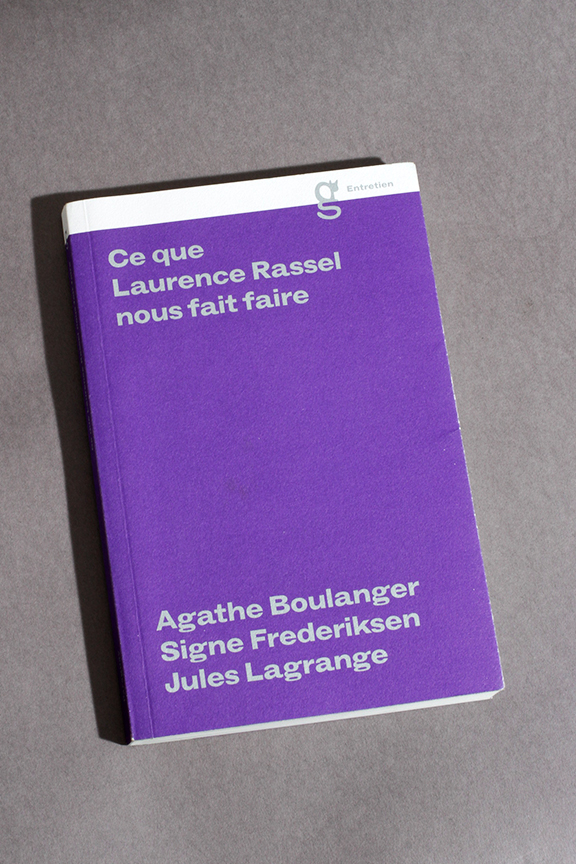
Agathe Boulanger, Signe Frederiksen, Jules Lagrange, Ce que Laurence Rassel nous fait faire, Paris, Paraguay, 2020 © Julien Richaudaud
Qu’est-ce qu’on fout là ? est la question fondamentale que se posait sans cesse Jean Oury, psychiatre et psychanalyste français, fondateur de la clinique de La Borde, comme une position éthique, une manière de se situer, sans laquelle on se retrouve absorbé·es par les habitudes, le ça va de soi, la passivité.
À partir du livre Ce que Laurence Rassel nous fait faire, cet atelier d’écriture est proposé aux étudiant es en école d’art. Il s’agira de penser ensemble les expériences institutionnelles que nous vivons dans le monde de l’art, à travers les formats de l’entretien, du groupe de parole et du voyage mental. Nous questionnerons ensemble d’où on vient, qu’est-ce qu’on fait là, et quelles institutions nous voulons habiter.
Ce livre d’entretiens avec Laurence Rassel, directrice de l’école de recherche graphique de Bruxelles, présente une pratique inspirée du féminisme, du logiciel libre, de la science-fiction et de la psychothérapie institutionnelle. Plus qu’une biographie, il s’agit d’un outil amenant à réfléchir sur les manières de travailler dans les institutions du monde d’art.
Les artistes Agathe Boulanger, Signe Frederiksen et Jules Lagrange se sont rencontré·es dans le programme post-diplôme de l’École nationale des beaux-arts de Lyon. Ce sont leurs intérêts croisés pour la pédagogie, les conditions de travail des artistes et la critique des institutions, qui les ont amené·es à réaliser cet ouvrage sur et avec Laurence Rassel. Par le biais de l’écriture et de la performance, Agathe Boulanger explore les différentes formes d’héritages affectifs. Ses recherches se concentrent sur les relations alimentées par le conflit et leurs modalités de conciliation. Signe Frederiksen écrit et met en scène des performances, en remettant en cause les interactions conventionnelles entre art et public. Elle assure également à l’occasion le rôle d’éditeur. Jules Lagrange, engagé dans une réflexion sur la décroissance, s’intéresse aux traditions vernaculaires de certains artisanats et aux émotions qu’elles engagent.
Laurence Rassel est née en 1967 à la frontière entre la Belgique, la France et le Luxembourg, dans un bassin sidérurgique en déclin qu’elle quittera pour entrer en école d’art à Bruxelles. Aux débuts des années 1990, elle se prend en pleine figure la différence de classe sociale et le mythe de l’artiste – un homme génial doué de talent – que propose l’école d’art de cette époque. La nécessité d’une forme d’auto-éducation s’impose, qui plantera les fondations de la pratique de Laurence Rassel : la découverte du cyberféminisme, le travail collectif, la survie avec une économie précaire et l’amitié surtout. Elle commence sa vie associative à l’organisation Constant, sous les radars institutionnels, où elle s’approprie les idées de l’open source. Cette expérience l’amène plus tard à imaginer l’ouverture des archives de la Fundació Antoni Tàpies à Barcelone, en tant que directrice. Aujourd’hui à l’école de recherche graphique de Bruxelles, elle porte un projet tourné vers le collectif, le processus et la transmission. Elle redéfinit la notion d’autorité et envisage une institution autonome, où chacun‧e a la possibilité de faire et d’agir sur la structure-même. Par son parcours de directrice et de commissaire d’exposition, Laurence Rassel mène des vies, plusieurs à la fois, et s’attache à rendre possible tout ce qui lui a manqué.
18h-20h. L’oxymore : un polar bizarre. Lecture et présentation par Fanette Mellier et Joseph Schiano di Lombo, auteur·rices de L’Oxymore, Éditions B42 (2021)
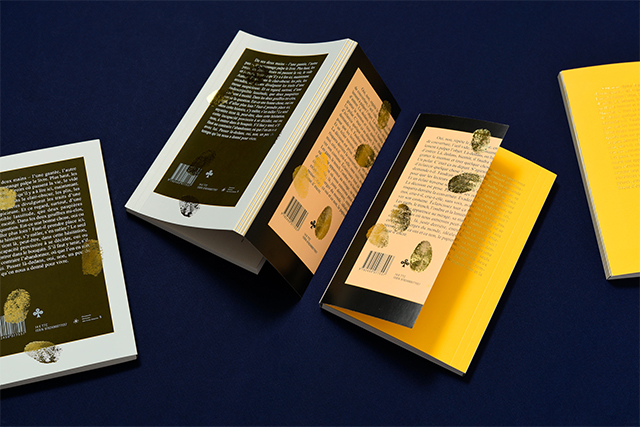
Fanette Mellier et Joseph Schiano di Lombo, L’Oxymore, Paris, Éditions B42, 2021
Pour dire ce qu’est ce polar, il faut commencer par dire ce qu’il n’est pas ; c’est-à-dire un polar. L’Oxymore serait-il dans ce cas un anti-polar ? À peine.
Pas une goutte de sang ne coule dans ces pages, pas un gramme de drogue ne circule ; pas même un petit viol sur le pouce. L’enquêteur, le commissaire, l’agent de police, le dealer, les femmes sulfureuses ou violentées, tout le monde a disparu. Et le but de ce livre n’est certainement pas de les retrouver.
Peut-on écrire un polar sans enquête ? Ou plutôt – puisqu’en littérature tout est possible si l’on manque suffisamment de révérence pour les règles – comment ? Dans quelle mesure et par quelles feintes désigner comme polar un livre qui nous refuse non seulement l’élucidation, mais jusqu’à l’intrigue elle-même ? Une telle direction s’éloigne certainement des horizons réconfortants auxquels ledit genre nous destine. De fait, refuser l’intrigue policière revient à faire le deuil d’un retour à l’harmonie antérieure à la chute. C’est enfin défaire la raison carrée, celle du méticuleux enquêteur, consentir à la beauté du vide sur lequel on s’agite, et bâiller devant la résolution provisoire d’énigmes par lesquelles notre besoin de connaissance est pourtant si facilement titillé.
L’Oxymore est ainsi un roman bizarre, un mouvement perpétuel, une boucle a priori scellée, un autre voyage vain de l’ombre qui aveugle à la lumière qui éblouit, en passant par toutes les teintes de la zone grise.
Née en 1977, Fanette Mellier est une graphiste française, diplômée en 2000 de l’École des arts décoratifs de Strasbourg. Spécialiste du graphisme imprimé, elle répond à des commandes, souvent atypiques, dans le domaine culturel. En parallèle de ces travaux de commande qui la confrontent à des problématiques diverses, elle s’investit dans des projets expérimentaux dans le cadre de résidences, cartes blanches et expositions. Elle est également l’autrice de plusieurs ouvrages, dont Matriochka (Éditions du livre, 2020), Aquarium (Éditions du Livre, 2018), et Les Livres magiques (deux ouvrages publiés aux éditions Memo, 2018).
Né en 1991, Joseph Schiano di Lombo est un artiste pluridiscipliné basé à Paris. Pianiste de formation classique, diplômé de l’École nationale supérieure des Arts décoratifs de Paris, il exerce aujourd’hui une activité tissée de pièces musicales, d’œuvres visuelles, de performances et d’écriture. L’Oxymore est son premier roman.
Partager